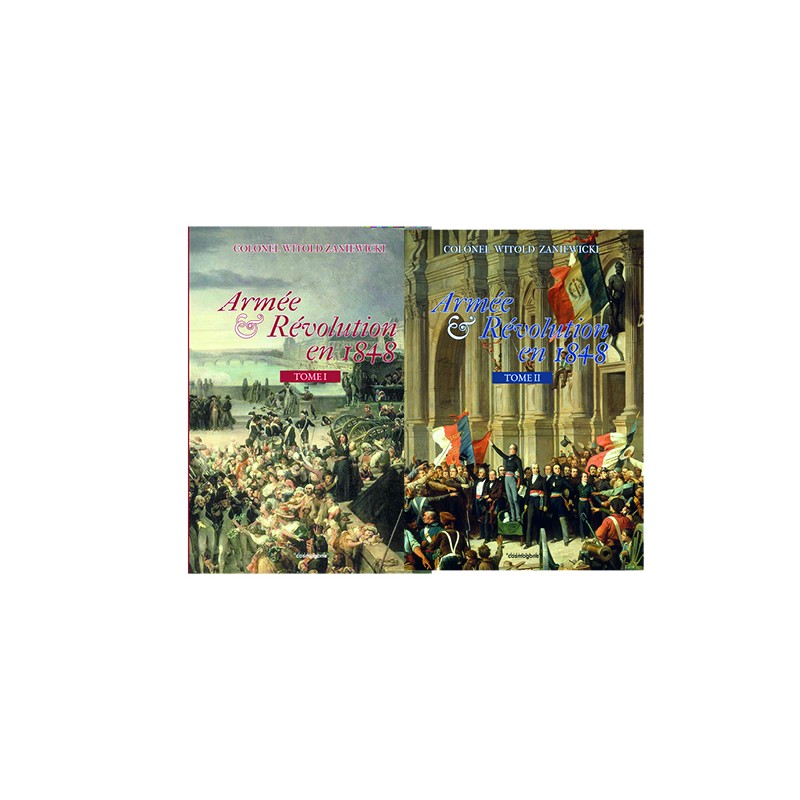
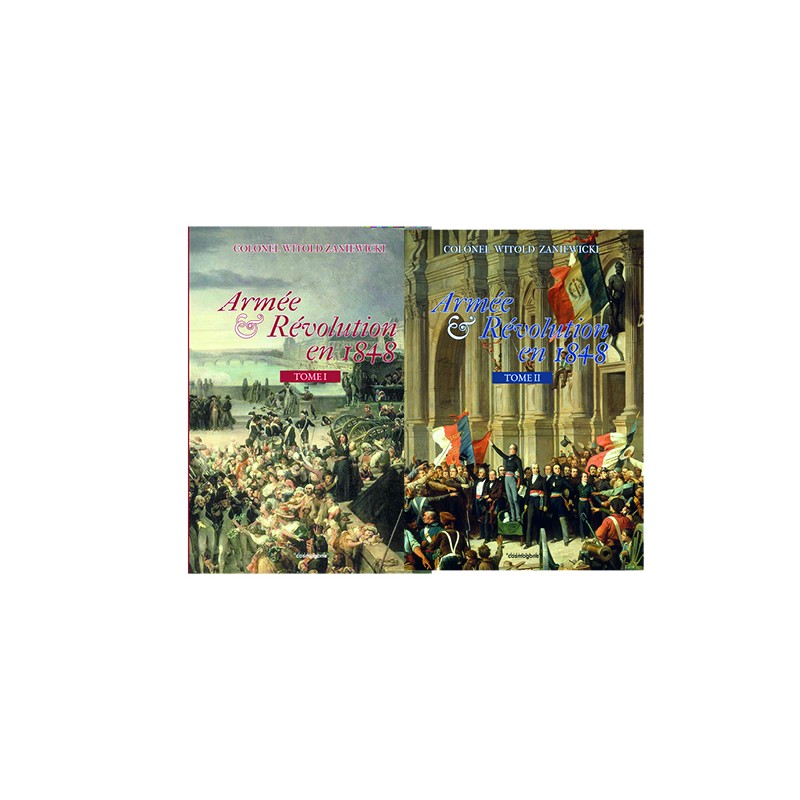
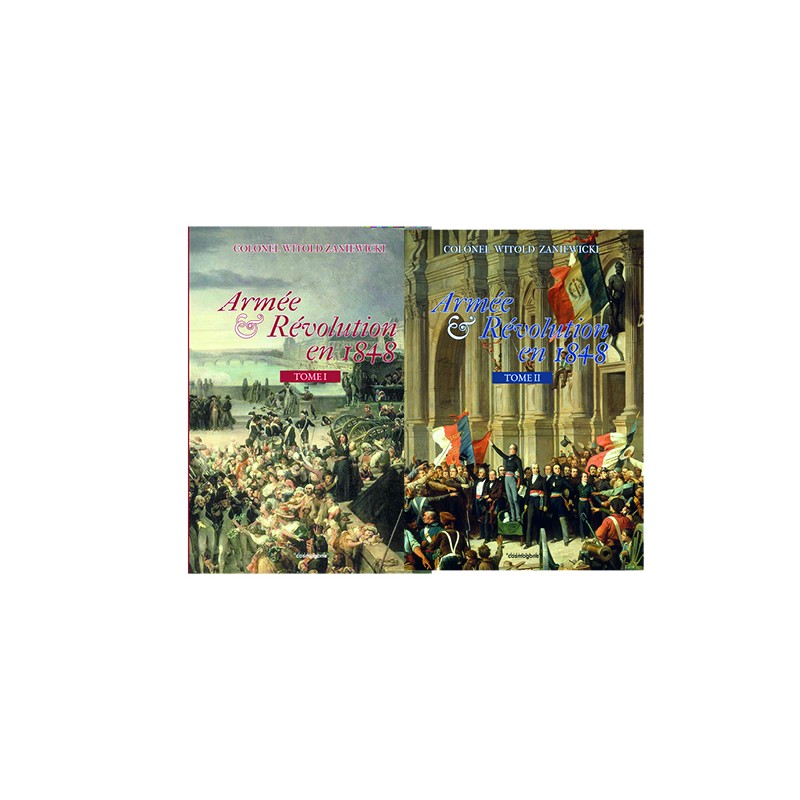
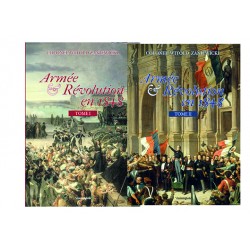

Colonel Witold ZANIEWICKI
TOME 1 = 212 PAGES + TOME 2 = 234 PAGES format 21 X 29.7 cm
Analyse détaillée de l'armée de 1848, Nombreuses références, cartes et archives.
| Professeur à l'école de guerre, a participé avec J. Delmas au renouveau de l'histoire militaire en France, en développant ses dimensions économiques et sociales. |
Toutes les conditions sont réunies pour qu’une grave crise morale ébranle l’armée française du 22 février au 20 décembre 1848. Les révolutions de février et de juin exacerbent de vieux conflits entre officiers et sous-officiers, font apparaître les défauts de structure et les insuffisances du haut-commandement, risquent de provoquer un divorce entre l’armée et la nation, créent un courant démagogique qui pénètre les troupes restées très populaires. La République demande aux unités un effort permanent : maintenir l’ordre dans les campagnes et les villes, instruire les nombreux rappelés, se tenir prêtes à combattre à l’extérieur. Elle leur crée des tâches supplémentaires : organiser les élections, remanier à plusieurs reprises leur organisation administrative, créer des unités de guerre. Toutes ces tâches se traduisent par d’incessants mouvements de troupes qui fatiguent les soldats et empêchent toute vie familiale possible aux cadres.
La crise d’indiscipline, au lendemain de février, est résorbée immédiatement par l’action énergique des cadres, surtout lorsqu’ils sont républicains, et par l’indifférence même des troupes. L’armée s’adapte très rapidement aux conditions nouvelles et remplit au mieux les missions qui lui font confiées. Sa modération lors des combats de juin traduit sa lassitude des guerres civiles, indifférente, n’est ni révolutionnaire ni réactionnaire, elle est avant tout nationale. Mais cette armée est très disciplinée : en février, l’échec du Plan Gérard est dû à l’attitude de la garde nationale : l’armée, entièrement soumise à l’autorité civile par les réquisitions, n’a pu que se laisser désarmer et quitter la capitale. Les troupes sont revenues à Paris le 15 mai : les opérations de maintien de l’ordre au début du mois de juin ont servi de répétition à la garnison. Cavaignac a su concentrer les unités présentes avec le maximum de rapidité, le matin du 23 et s’en servir efficacement contre l’émeute, tout en jouant un rôle modérateur dans la répression.
On retrouve partout cette idée-clef de discipline. C’est par discipline souvent que le soldat rend sur ordre ses armes en février, aux bourgeois de la garde nationale, par discipline qu’il se bat en juin contre l’ouvrier ou en province contre le paysan, plus proches de lui par l’origine, c’est par discipline qu’il adhère au gouvernement provisoire puis à la république, qu’il vote, même qu’il fraternise sur ordre, lors d’un banquet patriotique. Idée, très nouvelle en France, héritée de la monarchie de juillet, qui s’est lentement imposée au bout d’un demi-siècle de maniement d’armes à la prussienne, et qui a remplacé la fidélité au chef, encore vivante en 1830. En 1848, l’armée n’est pas coupée u peuple, il n’existe pas d’antimilitarisme ni de particularisme militaire exacerbé, mais la révolution de juin crée une première rupture ; l’armée indifférente politiquement s’est trouvée mise au service de la bourgeoisie au cours d’une guerre sociale ; coupée de ses sources populaires, elle en ressent une gêne diffuse qui lui fait encore plus espérer une guerre étrangère, Louis-Napoléon représente pour elle cet espoir. Déjà perceptibles sous la monarchie, les unités les plus républicaines n’ayant alors jamais hésité à intervenir contre les désordres, cette discipline abstraite s’affirme avec force, en 1848 ; c’est elle qui explique l’armée en face de la révolution et de la république.
Recension de Rémi BOYER :
L’analyse systématique des documents relatifs à l’armée française pendant la Deuxième République a conduit Witold Zaniewcki à revoir la représentation retenue d’une armée en crise morale.
« Le 22 février 1848, rappelle-t-il, la garnison parisienne s’apprête à mener une simple opération de police dont elle n’envisage pas l’échec et le général de Castellane écrit au ministre de la Guerre que tout est calme et qu’il pleut à Rouen. Le 20 décembre le Président de la République Louis-Napoléon Bonaparte, élu massivement au suffrage universel, compose son premier ministère. Entre ces deux dates si rapprochées, le roi a été renversé, plusieurs gouvernements se sont succédé, la guerre civile a fait rage à Paris, le pays entier est en proie au désordre, les émeutes se succèdent. Nous nous sommes demandé quels étaient les caractères et la structure exacte de l’armée héritée de la monarchie, quelle a été son attitude en face de la double révolution politique puis sociale, enfin quels furent ses rapports avec la république. »
« L’analyse systématique des mouvements des unités, de leurs effectifs et de leur organisation, des missions innombrables qu’elles eurent à remplir dans des conditions difficiles, nous a amené à réviser entièrement des positions qui nous paraissaient acquises. »
Un considérable travail d’investigation a permis à Witold Zaniewcki de préciser la nature complexe, les structures, les engagements de cette armée tiraillée par des bouleversements politiques et sociaux. Dans la première partie, il dresse un état des caractères et de la structure de l’armée en 1848. Le soldat est alors issu du peuple, y compris souvent l’officier puisque les bourgeois sont exemptés de service militaire par le système du remplacement. Qui plus est, le soldat a le droit de travailler en ville en dehors de son service quand il est en garnison. Issu su peuple, il reste mêler au peuple et à ses mouvements sociaux et politiques. C’est une armée sensible à son environnement populaire, très éloignée de nos armées d’aujourd’hui.
/image%2F0562708%2F20230801%2Fob_7b86b8_couv-witold-1848-2.jpg)
Afin de mieux comprendre cette situation si particulière en Europe à l’époque, Witold Zaniewcki s’intéresse d’abord aux troupes : le recrutement et les origines des soldats, les appelés, les remplaçants et les substituants, les engagés et les rengagés, les sous-officiers, les officiers, l’organisation, la chaîne de commandement… mais aussi la vie de la troupe et les opinions qui y circulent. Les sociétés secrètes ont perdu de leur influence au sein de l’armée, la dernière conspiration Carbonari date de 1821-1822. Les journaux républicains sont accessibles dans les casernes. Les doctrines sociales pénètrent plus aisément dans les armes spéciales où les soldats sont davantage instruits.
La deuxième partie de l’ouvrage étudie les positionnements de l’armée pendant la révolution, révolution politique d’une part avec l’attitude de la troupe selon les événements jusqu’au désarment des troupes du 24 février, révolution sociale d’autre part avec, principalement l’attitude des militaires à l’égard des insurgés pendant et après les combats de juin. Si les troupes de Ligne furent modérées dans leurs actions de maintien de l’ordre contre des « frères égarés », la milice nationale, vengeresse, ne fit preuve d’aucune hésitation.
La troisième partie consacrée à l’armée et la République cherche à mesurer l’engagement politique des troupes. En effet, l’armée est amenée à adhérer au Gouvernement Provisoire puis à la République. A deux reprises, ses membres sont invités à voter. Le gouvernement républicain utilise les possibilités nouvelles d’avancement pour favoriser l’adhésion aux idées républicaines. C’est un mouvement qui conduira les troupes vers la constitution d’une Armée de la République. Mais, il faudra attendre 1888 pour que cette armée bénéficie d’une réforme profonde et se transforme en armée moderne.
Ce livre n’est pas seulement une étude historique de l’armée française à une période de changements politiques profonds, il envisage les difficultés des soldats, issus du peuple, confrontés à des actions de maintien de l’ordre contre une partie du peuple. De ce point de vue, ce sont des considérations très actuelles et quasi universelles.